Marc
QUESTIN
LES
VISIONS NOIRES DE GRAHAM GREENE
Lecture
enrichissante des romans d’espionnage lorsque nous pénétrons dans ce royaume
imaginaire mais parfois bien réel des conflits politiques, sentimentaux et
religieux. Je crois avoir tout lu de l’écrivain anglais. Je suis toujours
emballé par cette volonté inexorable d’entraîner le lecteur à la suite de
ses aventures. Certaines ambiances de Graham Greene font songer à Ambler ou
à Somerset Maugham. Mais ce dernier s’est presque exclusivement cantonné dans
ses repaires de Malaisie, proche en ce sens de Conrad, avec cet humour britannique
parfois exaspérant quand il frise le plus impudent des colonialismes et que
l’on trouve surtout chez un Rudyard Kipling. Ce qui nous revigore dans l’univers de Graham
Greene c’est justement cette absence totale de sentiment de supériorité, cette
osmose sympathique qui le porte aussitôt vers les couches les plus défavorisées
de la population. Son christianisme ne m’a jamais embarrassé. J’y sens un
appel fluide de réconciliation, un désir instinctif de relier l’homme au cosmos.
Le solitaire d’Antibes est notre agent secret. Il y a chez Ambler un côté
trop technique. On se trouve prisonnier d’une rigueur inhumaine. Comme chez
John Le Carré, ce sont des drames patibulaires qui nous créent un malaise
qui nous englue à notre insu. Rien de tel chez Graham Greene ! On y sent de
la vie, de la joie, de l’humour. Bien que les hommes tombent comme des mouches.
C’est là le propre des services secrets. L’Ami américain témoigne à la perfection de ce mouvement
catastrophique. L’homme est le maître de son destin. Il ne croit pas au libre-arbitre.
C’est Dieu lui-même qui le dirige. Cette part terrible de liberté s’incarne
en Dieu, précisément. Nous sommes libres ET esclaves. Nous sommes libres d’être
esclaves ! C’est dans ce sens métaphysique que je peux lire un Graham Greene.
En cela qu’il me donne des leçons d’espérer. Pourtant, je ne suis pas chrétien.
Certes non. Mais cette démarche m’est sympathique. Son style plonge dans la
vie. Comme chez Goodis ou Buckovsky. Goodis, anti-héros, s’affronte
aux puissances de la nuit. Aucun espoir ne brille en lui. Mais pourtant...
L’un comme l’autre croient en Dieu. Goodis était
d’origine juive et le vaudou l’intéressait. Il croit aux forces et aux puissances.
Greene et Goodis sont des auteurs complémentaires.
Je crois que leur “théologie” a inspiré bon nombre d’auteurs contemporains.
Je pense à Peter Handke. Et revoici L’Ami américain
! Inspiré, je sais bien, de Highsmith, mais mis en scène par Wim Wenders.
Dans un décor allégorique. Avec froideur et précision. Handke et Burroughs
ont bien lu Greene et Goodis parle entre les lignes
des romans noirs de Peter Handke.
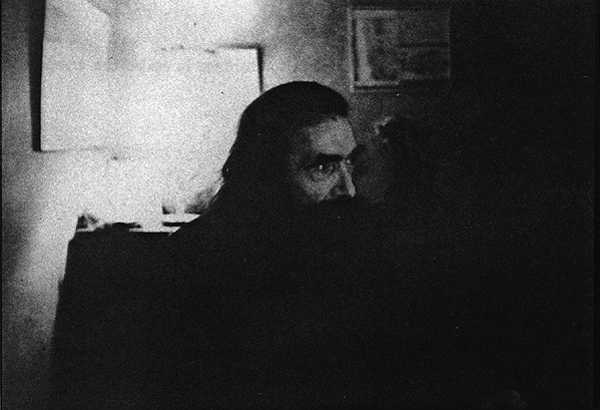
Un mois avant sa mort.
Photographie : Michel CAMUS